

|
Débat 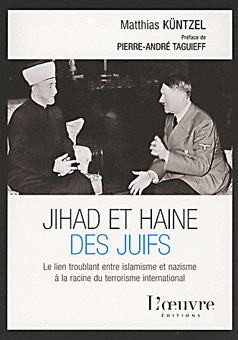 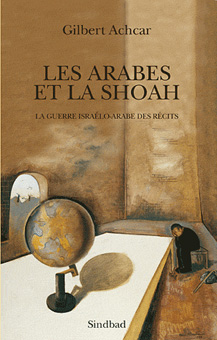
Hitler, les Arabes et les Juifs Nora Benkorich * Nora Benkorich recense ici les ouvrages suivants: Gilbert Achcar, Les Arabes et la Shoah, Paris, Sindbad, 2009, 525 p.; Matthias Küntzel, Jihad et Haine des Juifs, L’œuvre éditions, 2009, 238p. Martin Cüppers et Klaus-Michaël Mallmann, Croissant fertile et croix gammée, Éditions Verdier, 2009, 352 p. ***** Depuis quelques années, les travaux historiques consacrés au thème de la réception arabe de la Shoah et, plus généralement, des relations entre le monde arabo-musulman et l’Allemagne nazie, se multiplient et font débat. Dans ce sillage, l’ouvrage de Gilbert Achcar, Les Arabes et la Shoah, sorti en octobre 2009, se distingue tant par l’ampleur et la variété de sa bibliographie et de ses sources, que par ses efforts de conceptualisation, ses qualités scientifiques et, surtout, son souci constant de neutralité axiologique. Cette exigence méthodologique, qui devrait être une priorité dans tous les travaux ayant des prétentions scientifiques, mérite d’être soulignée, car les ouvrages consacrés à cette question ont une fâcheuse tendance à la contourner, voire à la mettre au placard. On peut citer, pour illustrer ce triste état de fait, les ouvrages Croissant fertile et Croix gammée de Martin Cüppers et Klaus Michaël Mallmann ainsi que Jihad et haine des Juifs de Matthias Küntzel, tous deux sortis en France en même temps que le livre de Gilbert Achcar. Le premier, traduction française de l’original allemand paru en 2006, présente un monde arabo-musulman uniforme, monolithique, unanimement antisémite, antisioniste et pronazi. Dominique Trimbur observe avec justesse une «véritable malhonnêteté intellectuelle et scientifique de la part des auteurs. En effet, ce qui est décrit, ce n’est pas une politique, ce ne sont pas les relations entre l’Allemagne nazie et le monde arabo-musulman, ce n’est qu’un ensemble de représentations mises bout à bout, devant faire office de tableau complet». Il ajoute, à juste titre, que «le recours par trop exclusif à une seule source archivistique, à savoir les archives nazies, ne peut en aucun cas servir à dresser un tableau complet, cohérent, équilibré et représentatif, tel qu’il est prétendument ambitionné par les auteurs».[1] Le second, Jihad et haine des Juifs, s’inscrit dans cette même veine. Le choix très sélectif des sources et le recours à des affirmations douteuses laissent le lecteur perplexe. S’ajoutent des jugements de valeurs qui n’ont pas leur place dans un livre d’histoire: prétendre qu’un «musulman orthodoxe» est par nature «hostile à la science» est la preuve d’une méconnaissance totale de la culture islamique. Plus choquantes encore sont les railleries sur les rites et les croyances musulmanes, telles que: «Les islamistes considèrent que baisser la tête jusqu’à la poussière du sol est signe de spiritualité» Küntzel fait référence à la prière, qui d’ailleurs n’est pas une pratique islamiste mais islamique et constitue l’un des cinq piliers de l’islam. Autre jugement: «Le Coran offre même au plus pauvre des croyants la consolation de dominer les femmes et la permission de participer aux purges religieuses» (p. 146). Comment ne pas y voir autre chose qu’un sentiment islamophobe ou une farouche inimitié de l’islam et de ses rites ? Ce qui est inquiétant, c’est que l’ouvrage de Cüppers et Mallman émane d’une institution officielle allemande – le Ludwigsburg, chargé de la poursuite des criminels de guerre et censé produire des travaux de référence – et que celui de Küntzel a été traduit dans une dizaine de langues et a reçu le prestigieux Independant Publisher Book Award (États-Unis)… Quel enjeu ? L’enjeu principal du débat historique suscité par ces publications consiste à mesurer la responsabilité des Arabes et des Musulmans – en particulier celle des Palestiniens – dans la mise en œuvre de la Shoah. On l’aura compris, les auteurs des deux ouvrages que je viens de citer établissent, par un procédé classique d’essentialisation du monde musulman, un réquisitoire accablant et sans nuances de cette responsabilité que l’on pourrait résumer ainsi: l’atavisme antisémite des musulmans les a prédisposés à se faire unanimement les instruments de l’extermination des Juifs. Il n’est guère surprenant de constater que les partisans de cette lecture essentialisante de l’histoire s’appuient sur la figure du Grand mufti de Jérusalem Amin al-Husseini pour conforter leur thèse. La collaboration entre le Troisième Reich et le mufti qui d’ailleurs, dans ses mémoires, n’a jamais tenté de dissimuler sa fascination pour le nazisme, est un fait avéré et n’est guère contesté. Toutefois, les raisons invoquées pour justifier cette alliance sont moins nettes. Henry Laurens y voit «une grande part d’opportunisme politique, même s’il a certainement été très sensible aux multiples égards que les responsables nazis lui ont prodigués» [2]. De son côté, Gilbert Achcar, qui assimile souvent les relations entre le Troisième Reich et les nationalistes arabes à une alliance tactique – fidèle à l’adage «l’ennemi de mon ennemi est mon ami» –, ne lui accorde pas même ces «circonstances atténuantes»: il est convaincu que le mufti a collaboré au nazisme par affinités idéologiques. Le mufti et le Troisième Reich Le portrait qu’Achcar brosse du mufti est celui d’un «égocentrique mégalomaniaque» (p. 231), accusé d’avoir exploité l’autorité religieuse que lui conférait son titre de mufti pour défendre une «pseudo-identité commune de vues entre le nazisme et la religion islamique» sur la question juive (p. 249) et d’avoir activement soutenu le régime national-socialiste – notamment en contribuant en personne à la formation et à l’encadrement des divisions SS bosniaques Handschar et Kama, créées en 1943 (qui en réalité ont plus servi à lutter contre les Serbes que contre les Juifs). Achcar rappelle par ailleurs qu’al-Husseini s’est employé à diffuser dans le monde arabo-musulman un discours antijuif – il évoque certains de ses nombreux brûlots exhortant au meurtre des Juifs, fondés sur une utilisation sélective du corpus islamique et sur la littérature européenne antisémite. Nul besoin de s’attarder sur la responsabilité du mufti: il est coupable d’avoir versé dans l’antisémitisme primaire et est unanimement cloué au pilori des «activistes collabos». Ce qui en revanche est contestable, c’est le procédé de métonymie employé par les «essentialistes», qui consiste à prendre la partie pour le tout, c’est-à-dire le mufti pour le monde arabo-musulman. Ce raccourci simpliste conclut que le monde arabo-musulman est coupable d’avoir collaboré avec les nazis et d’avoir voulu tuer des Juifs parce que le mufti l’a fait… Il est surprenant de voir qu’un philosophe et historien des idées comme Pierre-André Taguieff, qui nous a habitués à des syllogismes mieux charpentés, ait cédé à cette tentation. En effet, dans la préface qu’il consacre à l’ouvrage de Küntzel, Taguieff affirme, en conclusion de trois pages décrivant les rapports entre al-Husseini et les nazis, que «l’une des principales conséquences de cette politique d’alliance entre le nazisme et le monde arabo-musulman aura été “la convergence de l’antisémitisme et de l’antisionisme dans le régime nazi ” durant la Seconde Guerre mondiale» (Taguieff, préface de Küntzel, p. 23), réduisant ainsi le monde arabo-musulman dans ses rapports au nazisme à la figure du mufti. Cette assertion recèle une accusation hautement plus grave. Tout lecteur averti, en s’interrogeant sur la traduction en actes de cette prétendue «convergence de l’antisémitisme et de l’antisionisme dans le régime nazi», peut difficilement y voir autre chose que l’adoption par les nazis de la «solution finale» – avant de prendre des mesures d’extermination, les nazis ne s’opposaient pas au sionisme, qu’ils voyaient comme un moyen de se débarrasser de «leurs» Juifs en les envoyant en Palestine [3]. En résumé, le mufti – donc aussi le monde arabo-musulman si l’on s’en tient à la réduction préalablement établie par Taguieff – aurait joué un rôle de poids dans l’adoption de la «solution finale» par les nazis. Dans l’état actuel de la recherche, cette assertion est improbable, car il n’existe aucune preuve empirique permettant de l’ériger en réalité historique. Dans ses mémoires, al-Husseini affirme avoir été informé de la «solution finale» au cours d’une discussion avec Himmler l’été 1943 [4] – ce qui d’ailleurs ne changea rien à sa ligne politique collaborationniste. Notons que dans ses écrits postérieurs à la Seconde Guerre mondiale, il n’a jamais nié l’existence du génocide juif ni le nombre de ses victimes, ce qui donne un certain crédit à son propos. Il s’est contenté d’affirmer que cela n’était pas «son problème» – la médiocrité morale du personnage s’en trouve bien illustrée. Toutefois, s’il s’est fait le complice du projet d’extermination, on ne peut empiriquement soutenir qu’il en est à l’origine. Notons à cet égard que les travaux de Saul Friedländer, grand spécialiste de la Shoah, n’évoquent nulle part cette hypothèse. Passons sur le cas du mufti qui a déjà fait couler beaucoup trop d’encre pour entrer au cœur de l’ouvrage qui nous intéresse. Gilbert Achcar, à contre-courant de la tendance «essentialisante», établit un état des lieux bien plus contrasté et plus honnête intellectuellement. Il distingue quatre grands courants de pensée dominants au Moyen-Orient à l’époque de la Seconde Guerre mondiale, dont la collaboration et/ou l’acceptation du national-socialisme fut à géométrie variable: le «panislamisme réactionnaire», le «nationalisme», l’ «occidentalisme libéral» et le «marxisme». Panislamisme réactionnaire, nationalisme et collaboration Achcar démontre que le courant du «panislamisme intégriste», dans lequel est classé le mufti, s’est montré le plus complaisant vis-à-vis du nazisme, en dépit des incompatibilités idéologiques inhérentes à son essence néo-païenne – le culte d’Hitler, élevé au rang de quasi-Dieu, était en effet difficilement compatible avec le principe islamique d’unicité divine. Enclins à percevoir le monde comme animé par le prisme religieux des premiers siècles de l’islam, les panislamistes réactionnaires ont rapidement appréhendé le conflit palestinien en termes de guerre de religions opposant les Musulmans – et leurs alliés – aux Juifs. Chez les nationalistes arabes, explique Achcar, l’Allemagne nazie, perçue comme ennemie de la Grande-Bretagne, a suscité des sympathies d’intensités variables, en particulier dans les pays sous domination britannique – en Egypte, en Irak et surtout en Palestine, où l’antisémitisme était conçu par les plus frustes comme un rempart contre le sionisme. Le Parti syrien nationaliste arabe, fondé par le germanophile et admirateur d’Hitler Antoun Saadeh, a sans doute été le plus proche du modèle nazi – le drapeau de son parti était d’ailleurs calqué sur le drapeau nazi, avec les couleurs rouges et noires inversées et une hélice à quatre pales à la place de la croix gammée. Achcar affirme que la conscience réactionnaire de Saadeh a atteint des sommets totalitaires inégalés au Moyen-Orient (p. 128-129). Mais, malgré ses excès de zèle, il n’est parvenu à susciter d’intérêt ni chez les masses arabes, ni auprès des autorités allemandes – qui rejetèrent ses requêtes de soutien, ce qui le conduira à nier par la suite toute proximité avec le nazisme. En Égypte, Achcar montre que l’organisation Misr al-Fatât (Jeune Égypte), inspirée par la vague montante du fascisme européen, n’a guère été prise au sérieux par le régime nazi avec lequel elle entretint des rapports en «dents de scie» – ce qui ne l’empêcha pas de verser dans l’antisémitisme, en paroles mais aussi en actes [5]. Les ultranationalistes irakiens, qui au départ assimilaient le nazisme à une forme de colonialisme, ont pris un tournant pronazi au printemps 1941, après le renversement du putschiste Gaylânî par l’armée britannique. Le pogrom Farhûd de juin 1941, fomenté par les putschistes déchus décidés à faire des Juifs les boucs émissaires de leur frustration, en fut la triste illustration. Toutefois, Achcar précise qu’au cours de cet événement, la violence antijuive, perpétrée par une petite minorité, fut réprouvée par la population et que les émeutiers furent rapidement dispersés par les tirs de l’armée irakienne. Notons avec l’auteur que ces cas étaient marginaux: la plupart des nationalistes arabes qui se sont rapprochés de Berlin l’ont fait moins par connivence idéologique avec le nazisme que par haine du colonisateur britannique et par volonté de libérer la nation arabe de son joug. Si la collaboration avec l’Allemagne nazie de ces mouvements panislamistes intégristes ou nationalistes est un fait établi, elle fut loin de rencontrer l’assentiment général. La majorité des indépendantistes libéraux, des nationalistes «progressistes» et l’ensemble des marxistes rejetaient le nazisme comme négation de leurs valeurs, explique Achcar. Ils voyaient en Hitler «le plus grand ennemi de l’humanité» (p. 81) et considéraient la Grande-Bretagne comme un moindre mal. Indépendantistes occidentaux, marxistes et rejet du nazisme Imprégnés du système de valeurs culturelles «modernistes» issues des Lumières, les «occidentalistes libéraux» se sont dès le départ opposés à la fois au nazisme par humanisme et au sionisme par anticolonialisme. Ils condamnaient fermement l’antisémitisme, cette «pensée arriérée et sauvage qui consiste à persécuter, au nom de la race, les divers éléments qui composent la nation entière [6]». Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils représentaient le courant de pensée le plus influent, y compris en Palestine – malgré le succès de l’aile radicale du mouvement national dirigée par Amin al-Husseini. Ce fut cette voix qui fut portée au cours de la réunion sur la question de la Palestine du 7 octobre 1944 à Alexandrie, présidée par les chefs des gouvernements de Égypte, de l’Irak, de la Jordanie, du Liban et de la Syrie, comme en témoigne la résolution spéciale prononcée à son terme: «nul ne regrette plus que [le comité] les malheurs infligés aux Juifs d’Europe par les États dictatoriaux européens. Mais la question de ces Juifs ne doit pas être confondue avec le sionisme, car il n’y a pas de plus grande injustice que de résoudre le problème des Juifs d’Europe au moyen d’une autre injustice, c’est-à-dire en infligeant une injustice aux Arabes de Palestine» (p. 83). Pour ce qui est des marxistes arabes, Achcar explique qu’ils ont adopté cette même attitude de rejet à la fois du sionisme et du nazisme, qu’ils percevaient comme les «deux faces d’une même médaille» et renvoyaient «dos à dos» [p. 89]. Engagés dans un combat cabré contre le nazisme dès l’avènement du Troisième Reich, leurs activités furent freinées entre août 1939 et juin 1941 par le pacte Ribbentrop-Molotov, considéré par certains comme une grave erreur et ouvertement critiqué. Ainsi, le palestinien Najâti Sidqi, délégué de l’Internationale syndicale rouge à Moscou, fut exclu par des «camarades» en 1940 pour avoir publié une série d’articles sur l’incompatibilité du nazisme et de l’islam. En termes de classes, ce courant percevait le sionisme comme une tentative des «capitalistes juifs» de détourner les «ouvriers juifs» des objectifs de la révolution. Par ailleurs, il dénonça avec ferveur la «connivence entre sionistes et nazis» sur la question palestinienne. Ainsi, dans un discours prononcé en 1943, le secrétaire général du Parti communiste Ridwân al-Hilû affirmait que «le sionisme considère la terreur antijuive comme bienvenue et […] entrave tout projet susceptible d’orienter l’émigration vers un autre pays que la Palestine, comme ce fut le cas lors de la conférence d’Evian [7] […] lorsque […] l’Agence juive s’opposa à tout projet susceptible de dévier l’émigration des Juifs de la Palestine, préférant qu’ils restent en Allemagne sous la torture, la terreur et la privation plutôt que de les transporter ailleurs [8]». On peut retenir avec Achcar, pour jauger l’ampleur du mouvement réfractaire au nazisme dans le monde arabe, qu’il y eut globalement plus d’Arabes dans les armées alliées ou dans les camps de concentration nazis que de volontaires engagés aux côtés de l’Axe. Après la Shoah La Nakba, l’expulsion des Palestiniens consécutive à la création de l’État d’Israël, a porté un coup fatal aux occidentalistes libéraux et aux marxistes, accusés d’avoir soutenu des gouvernements favorables au sionisme – au cours de la guerre de 1948, Staline a fourni la Haganah, bras armé de l’exécutif sioniste, en armes. Le panislamisme intégriste a été discrédité par la défaite du mufti et par le soutien inconditionnel des Saoudiens aux Britanniques. Seule la mouvance nationaliste est sortie renforcée par cette épreuve, du moins jusqu’à la défaite arabe de 1967, avant de céder devant la montée ombrageuse de l’islamisme, illustrée par la révolution iranienne de 1979. À compter de cette période, deux paradigmes idéologiques symétriques, l’un d’essence néo-sioniste – prééminent chez les intellectuels israéliens – et l’autre inspiré de l’islamisme radical – que l’on retrouve en Iran –, se sont progressivement imposés. Enfermés dans une vision narcissique du passé, du présent, et de l’avenir, les porte-parole de ces deux modèles se sont livrés – et se livrent encore – à une surenchère déplorable dans la négation de la souffrance de l’autre et dans l’exacerbation de sa propre souffrance – Nakba contre Shoah. Les termes de l’équation sont tragiques. Cette posture de repli sur soi, d’incapacité à faire preuve d’empathie et cette tendance à essentialiser l’autre en postulant l’immuabilité de son être, est la désastreuse marque de notre époque actuelle sur la question du conflit israélo-palestinien – en dehors de quelques esprits qui tentent d’y échapper. On comprend combien le recours sélectif, voire manipulateur, au passé ne fait que conforter cette situation. Au lieu d’une navrante surenchère de victimisation, il faudrait arriver à une nécessaire compréhension de la souffrance de l’autre, étape indispensable pour parvenir à une vraie réconciliation. Dans ce contexte, on ne peut que saluer l’exemplarité de l’ouvrage de Gilbert Achcar, qui œuvre dans ce sens. *Nora Benkorich a publié cette recension dans la Vie des Idées. 1. Dominique Trimbur est chercheur associé au Centre de Recherche français de Jérusalem. Les passages cités sont tirés d’un compte rendu paru dans la Auschwitz Foundation’s Review. 2. H. Laurens, «La Haine de l’autre», L’Orient le jour, 3 décembre 2009. 3. L’Allemagne nazie a d’ailleurs signé un accord de transfert avec le mouvement sioniste, l’accord de la Haavara, le 25 août 1933. 4. Amin al-Husseini, Mudhakkirat al-Hajj Amin, cité par Henry Laurens, La Palestine, Fayard, tome 2, p. 469. 5. Jeune Egypte fut à l’origine de la campagne d’agitation antijuive de 1939, qui appelait notamment au «boycott du commerce juif». 6. Joseph Achcar, cité par Gilbert Achcar, p. 67. Père de Gilbert Achcar, Joseph Achcar fut un partisan du courant des «occidentalistes libéraux». 7. Au cours de la conférence internationale d’Evian, qui s’est tenue en juillet 1938, les représentants de trente deux pays (dont la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne) ont affirmé ne pas être en mesure d’accueillir de Juifs – le représentant français a par exemple expliqué que la France avait atteint «le point d’extrême saturation en ce qui concerne les étrangers». 8. Cité par Gilbert Achcar, p. 94. À ce propos, notons que David Ben Gourion, ardent sioniste, a affirmé que «plus dure sera l’affliction, plus grande sera la force du sionisme» (Shabtai Teveth, Ben Gurion: The Burning Ground, 1886-1948, Houghton Mifflin, Boston, 1987, p. 850, cité par Achcar p. 34). (3 août 2010) case postale 120, 1000 Lausanne 20 |